Résumé éditeur
Molly est frappée par la pire des malédictions. Aussi les règles sont-elles simples, et ses parents les lui assènent depuis son plus jeune âge. Si tu vois une fille qui te ressemble, cours et bas-toi. Ne saigne pas. Si tu saignes, une compresse, le feu, du détergent. Si tu trouves un trou, va chercher tes parents. Molly se les récite souvent. Quand elle s’ennuie, elle se surprend à les répéter sans l’avoir voulu... Et si elle ignore d’où lui vient cette terrible affliction, elle n’en connaît en revanche que trop le prix. Celui du sang. « Un déferlement de chair et de tension audacieux, à la fois horrifiant et familier. » The New York Times Les Meurtres de Molly Southbourne, finaliste des prix BSFA 2017 et Shirley Jackson 2017, est lauréat du prix Nommo 2018. Né à Londres mais ayant grandi au Nigeria, Tade Thompson vit désormais dans le sud de l’Angleterre, où il exerce la profession de psychiatre. Âgé d’une quarantaine d’années, il est l’auteur de plusieurs dizaines de nouvelles et d’une poignée de romans, dont Rosewater, qui inaugure la trilogie « Wormwood », tout juste traduit chez J’ai lu. Les Meurtres de Molly Southbourne est en cours d’adaptation cinématographique.
Mon avis
L’odeur métallique du sang se mêle ici à celle, presque douce, du lait chaud qu’on verse dans un verre tremblant. Il y a, dans Les Meurtres de Molly Southbourne, quelque chose de la berceuse qui tournerait mal, un frisson velouté qui s’insinue lentement sous la peau avant d’y poser une morsure discrète. Imaginez une maison isolée, tapissée d’ombres dociles ; une jeune fille qui sourit à son reflet — avant que ce dernier ne décide de l’étrangler. L’univers semble d’abord minuscule, réduit à quelques murs, un jardin, des flaques où la mémoire s’éparpille ; pourtant, chaque page ouvre une trappe vers une angoisse plus vaste, presque cosmique. Lire ce roman, c’est s’asseoir au bord d’un puits et contempler le visage mouvant des ténèbres, tout en se demandant (avec une politesse toute britannique) si la corde tiendra.
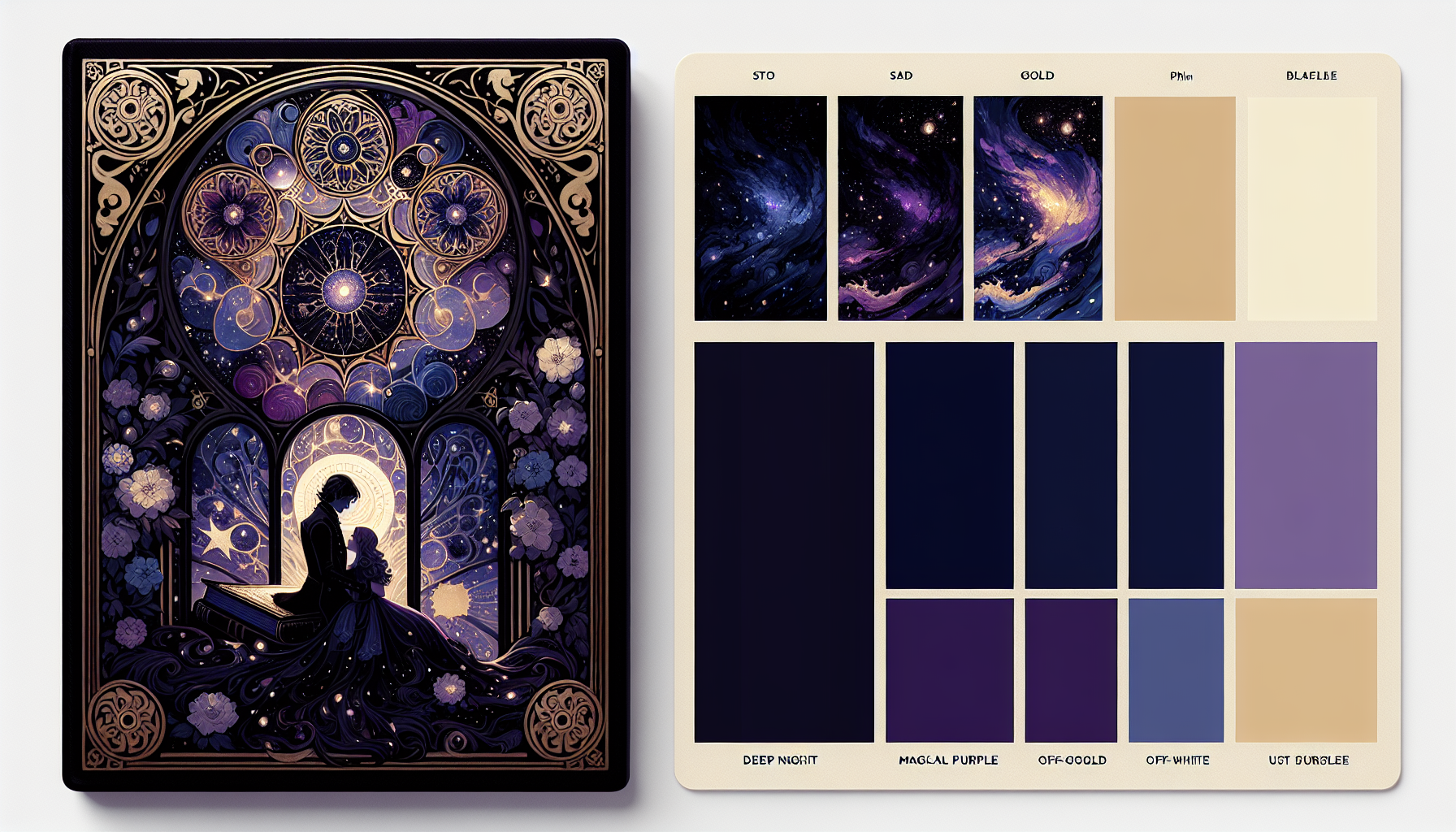
La découverte d’un huis clos sanglant
Je me souviens de ma première rencontre avec le nom de Tade Thompson : un murmure venu d’Angleterre, où l’auteur nigérian s’était déjà distingué avec sa trilogie Rosewater, déroutante et visionnaire. Ici, il troque les orbes aliens pour un face-à-face beaucoup plus intime — presque cruel — avec l’identité et la violence. Publié chez Le Bélial, ce petit volume de 118 pages s’avère un concentré d’adrénaline et de poésie sanglante. Les Meurtres de Molly Southbourne ne raconte pas seulement une histoire : il dissèque la peur même d’être soi.
En ouvrant le livre, on pense d’abord à un conte gothique, un peu rétro, à la Shirley Jackson : une maison, une fille, un secret. Puis la mécanique se dérègle. Chaque fois que Molly saigne, un double d’elle-même naît, implacable et meurtrier. Ce n’est pas une figure métaphorique de l’adolescence — quoique —, c’est une règle biologique, une malédiction inscrite dans la chair. L’absurde et le tragique s’entrelacent, comme si Kafka avait pris le thé avec Margaret Atwood. Thompson nous place au cœur d’un paradoxe : pour survivre, il faut s’entretuer. Pour exister, se mutiler. Et pourtant, malgré le carnage, la délicatesse rôde — une forme de tendresse tordue envers ces clones condamnés à mourir.
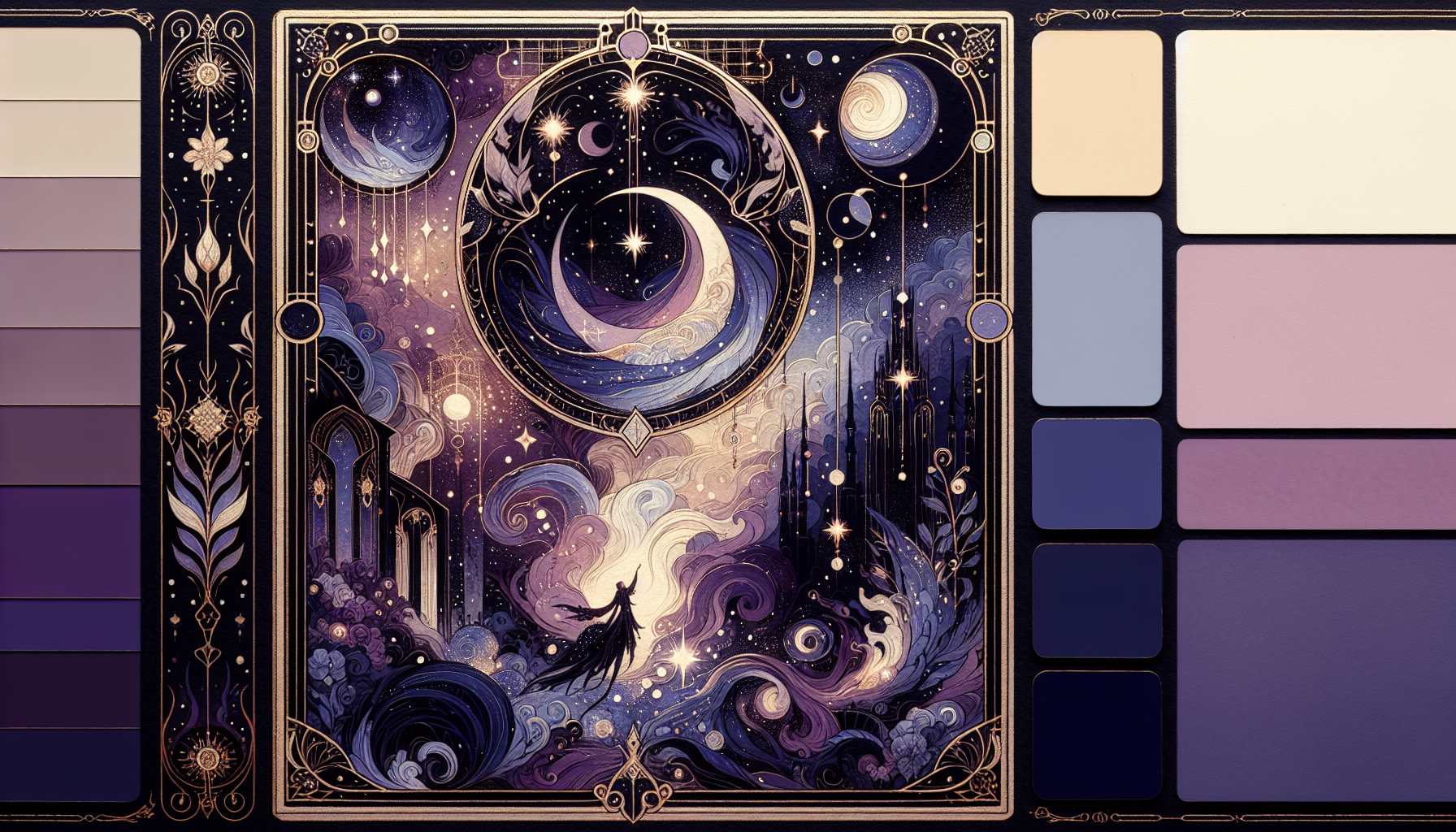
Un univers intime et monstrueux
Disons-le simplement : Les Meurtres de Molly Southbourne est un roman court, mais il résonne comme une cathédrale d’échos. Derrière sa structure presque minimaliste — journal de survie, fragments de souvenirs, narration à la première personne — se cache une orchestration d’une précision redoutable. La voix de Molly, mesurée, analytique, glisse souvent vers la folie, mais sans jamais perdre la retenue d’une bonne élève. C’est cette dissonance, ce ton presque clinique au milieu du massacre, qui donne à l’histoire son étrangeté hypnotique. Lire ces pages, c’est comme regarder une tempête à travers une vitre impeccablement propre : on distingue chaque goutte, mais on sent le vertige du chaos tout proche.
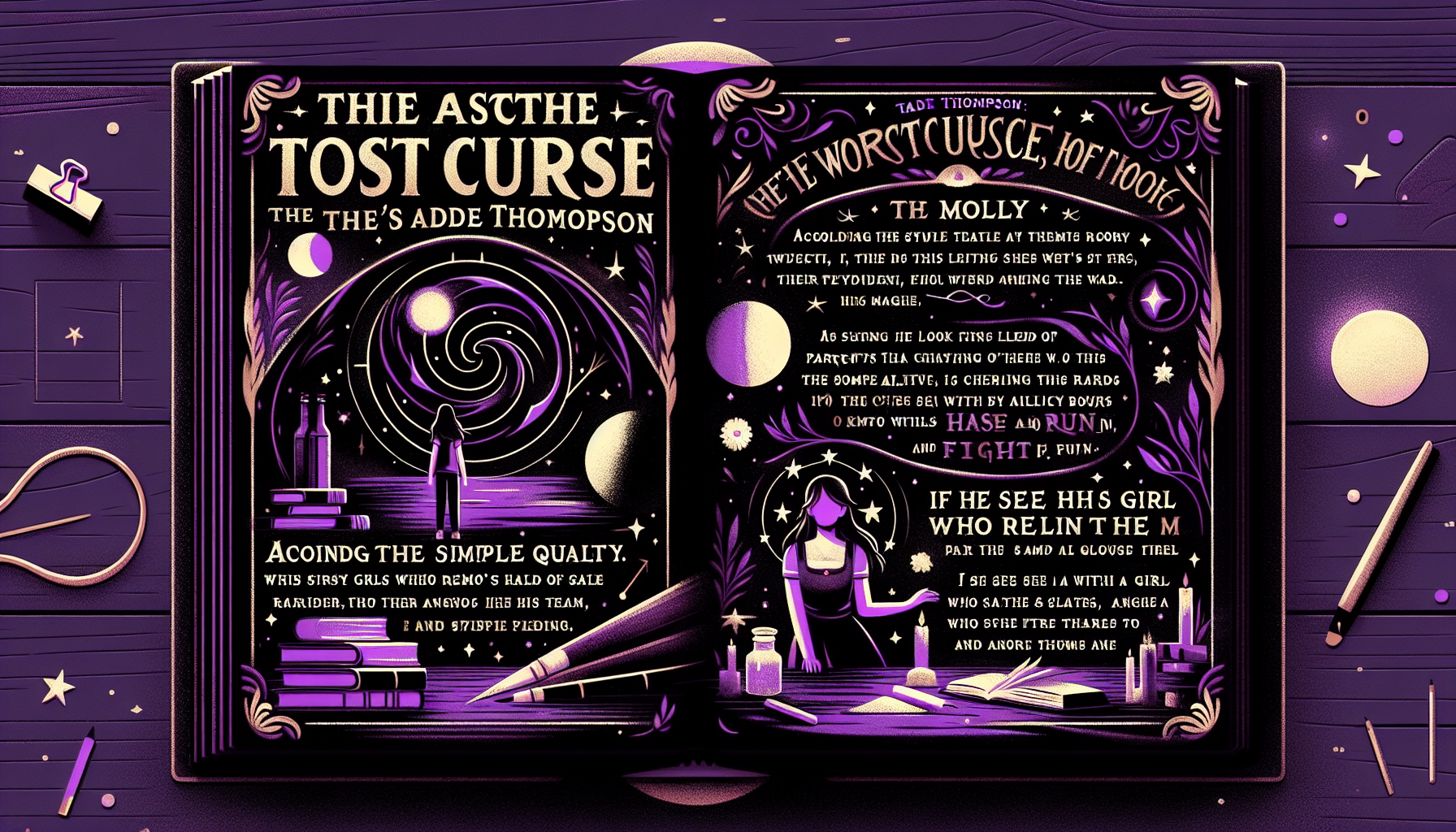
Thompson déploie un talent presque chirurgical dans la description de l’espace clos : la ferme, le sous-sol, la salle de bain transformée en champ de bataille. Tout prend une dimension symbolique, sans que le symbole n’alourdisse le récit. L’univers, pourtant restreint, s’élargit à mesure que l’on comprend que la malédiction de Molly pourrait n’être qu’un symptôme d’un monde plus vaste et détraqué. C’est là la ruse de Tade Thompson : il ne montre pas, il suggère, comme un illusionniste qui, au lieu de révéler le truc, vous fait douter de ce que vous venez de voir.
L’écriture, d’une sobriété élégante, oscille entre réalisme cru et poésie organique. Les descriptions sont sensorielles, parfois cliniques, parfois presque musicales — on songe à un quatuor de cordes jouant sur des nerfs à vif. Le style ne s’embarrasse pas de fioritures inutiles : chaque phrase respire l’efficacité et la tension contenue. La beauté du texte vient de sa retenue, de sa manière de faire naître l’émotion là où la violence devrait anesthésier. On pense à Kazuo Ishiguro pour cette économie d’effets, à China Miéville pour la noirceur veloutée, ou encore à Jeff VanderMeer pour les mutations du moi.
Et puis il y a le thème, omniprésent, de l’identité fracturée. Les doubles de Molly, appelées parfois « autres Molly », sont des reflets imparfaits, des versions qu’elle doit détruire pour continuer à respirer. L’idée, vertigineuse, parle autant de la construction du soi que de la culpabilité d’exister. Comment ne pas voir, dans ce ballet de morts en série, une métaphore de nos contradictions quotidiennes ? Chaque décision, chaque honte, chaque regret engendre une version alternative de nous-même. Thompson pousse ce concept à sa limite biologique, et la frontière entre le réel et le symbolique se dissout dans un brouillard fascinant.
La structure du roman épouse ce vertige : le récit, d’abord linéaire, se fissure comme un miroir ; les souvenirs s’entrechoquent, les temporalités se mêlent, les repères vacillent. Le lecteur devient complice d’une confusion presque confortable — une sorte de somnolence lucide, celle-là même qu’on ressent devant les meilleurs épisodes de Black Mirror ou en relisant Ubik. Ce n’est pas tant l’intrigue qui importe que la texture mentale qu’elle tisse, cette impression que la réalité n’est qu’une succession de reflets mal ajustés.
Enfin, parlons du rythme : haletant, mais non pressé. Le texte respire entre deux effusions de sang, ménage des silences où l’on se surprend à entendre le pouls du monde — ou celui du lecteur. Il y a, dans cette respiration maîtrisée, une véritable science de l’économie narrative. On n’en sort pas indemne, mais on en ressort étrangement apaisé, comme après avoir entendu une symphonie dissonante dont la dernière note se perd dans le vent.
Les forces de ce petit bijou rougeoyant
Ce qui frappe d’abord, c’est la densité émotionnelle : rares sont les livres si courts capables d’ouvrir autant de portes secrètes. Les Meurtres de Molly Southbourne mérite amplement ses 9.2/10 assumés, non par perfection technique, mais par la puissance de son résonnement. L’histoire n’est pas seulement bien écrite ; elle paraît nécessaire. Le mélange entre huis clos, horreur psychologique et questionnement identitaire forme un équilibre fragile, mais fascinant. Thompson ne moralise jamais, il raconte — et laisse le lecteur ramasser les morceaux.
Le style, économe et tendu, confère à chaque ligne la saveur d’une lame polie. La lecture se fait immersive sans effort, portée par une musicalité de phrases que l’on croirait murmurées à l’oreille. Quant à l’univers, limité en apparence, il s’élargit comme une spirale : du corps à la conscience, de la douleur à la transcendance. Les personnages secondaires — les parents, les professeurs, les ombres — ne sont que des silhouettes, mais chacun laisse une empreinte vocale, presque spectrale. La cohérence interne du récit tient du miracle d’équilibriste. Rien n’est gratuit, rien n’est en trop.
Bien sûr, tout n’est pas d’une perfection clinique. On aurait aimé, parfois, un souffle plus ample, quelques détours vers le monde extérieur. La brièveté, si efficace, laisse aussi une petite frustration : on

